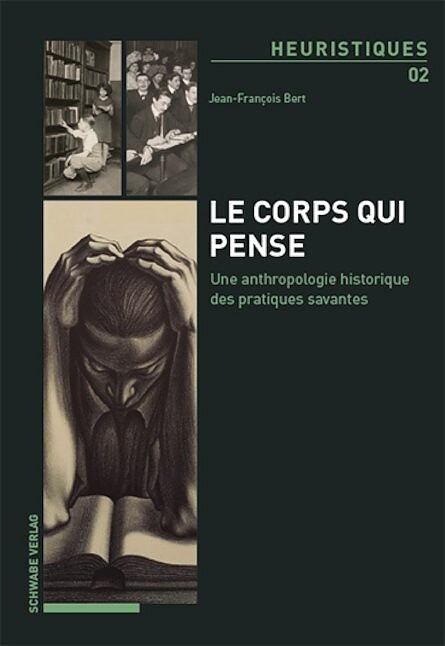Halawi H. W., Le droit ismaélien druze (XVe-XVIIe siècle). Édition critique et traduction annotée du Précis inédit du Shaykh al-Fāḍil, Editions de la Sorbonne, 2024

Les Druzes forment une communauté musulmane ésotérique dont la doctrine spirituelle a pris racine dans l'ismaélisme du Caire fatimide du Ve/XIe siècle. Leur pensée, en harmonie avec le shi'isme primitif, porte un regard nouveau sur la notion de divin, ainsi que sur le statut du Coran et du prophète Muhammad ; elle fut ainsi reléguée au rang d’hérésie étrangère à l’islam. La doctrine juridique des Druzes a ensuite été élaborée dans le contexte rural et clanique de la Syrie mamelouke du IXe/XVe siècle, lors de la formation d’une école doctrinale de droit (madhab) druze. Leurs traités juridiques, rédigés entre le IXe/XVe siècle et le XIe/XVIIe siècle, jettent les fondements de ce nouveau madhab en Islam.
Quelles relations les principes de la religion druze, au cœur de la doctrine juridique, entretiennent-ils avec l’ismaélisme ? Le Coran est-il une source de droit druze ? Et qu’en est-il de la Hikma (Sagesse), le livre saint des Druzes ? L’influence du fonctionnement des grandes familles rurales sur l’élaboration d’un droit religieux druze permet enfin d’interroger la place du droit coutumier dans l’organisation de la communauté. Les femmes druzes avaient-elles un statut particulier différent du droit sunnite et shi’ite ? Le droit matrimonial druze et l’interdiction des mariages mixtes présentaient-ils une particularité religieuse ou sociale ? Wissam Halawi étudie ces thèmes d’après un traité juridique inédit du XIe/XVIIe siècle, qu’il confronte au corpus juridique druze du IXe/XVe siècle.